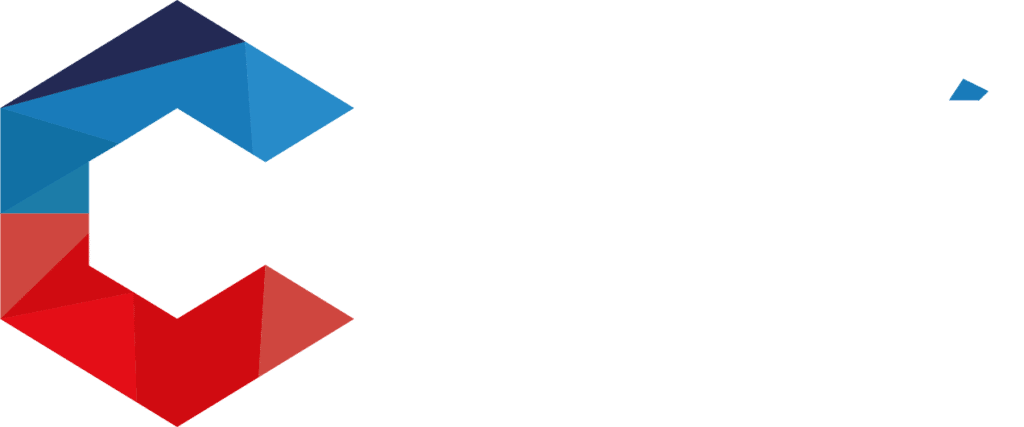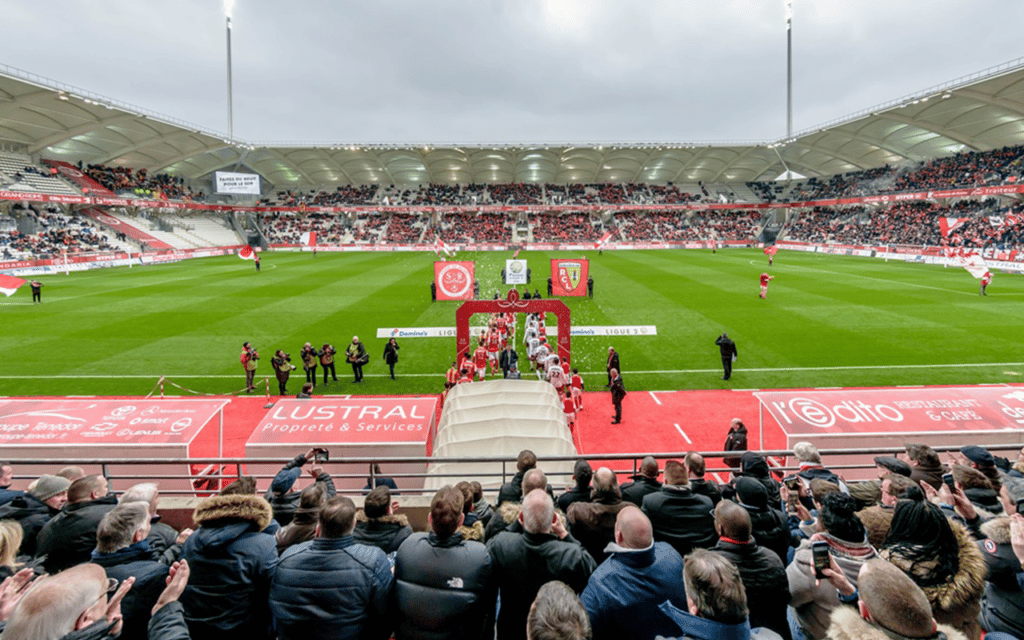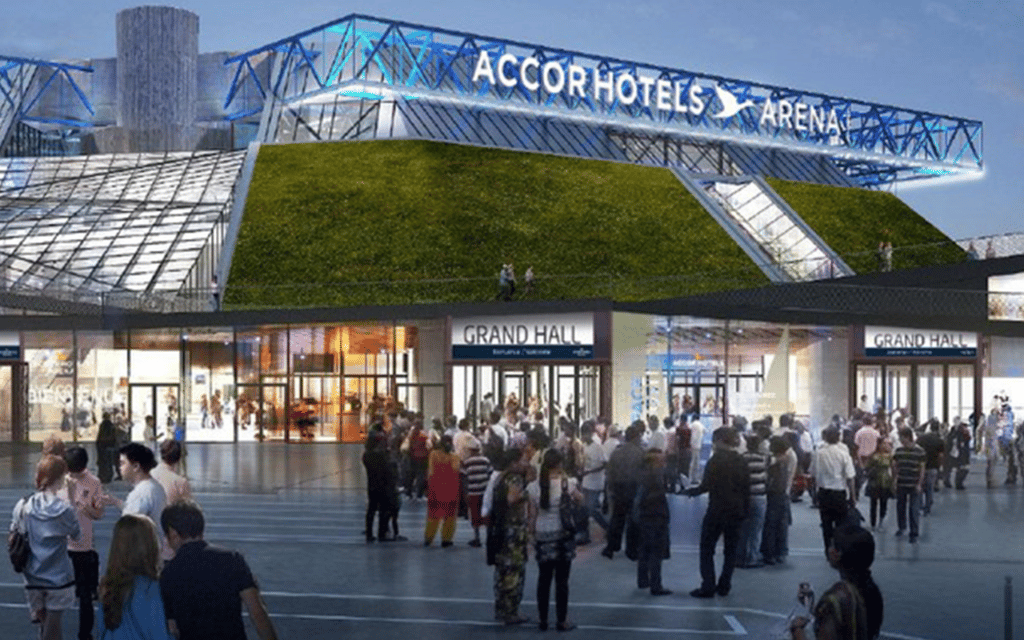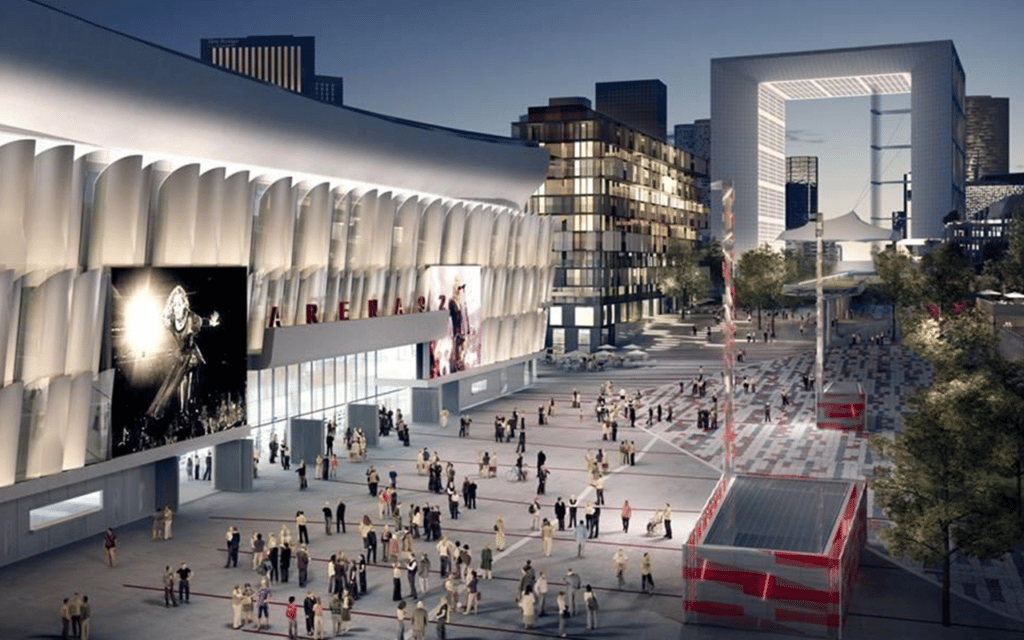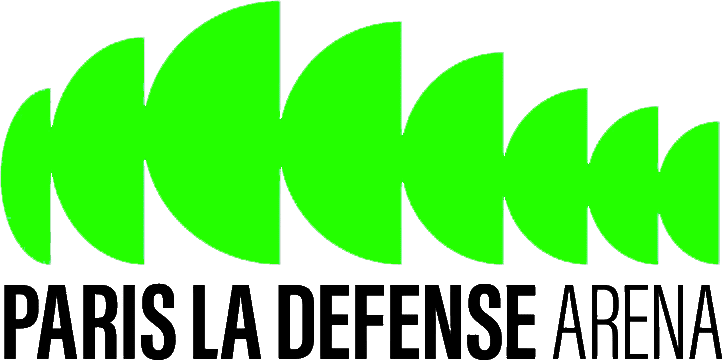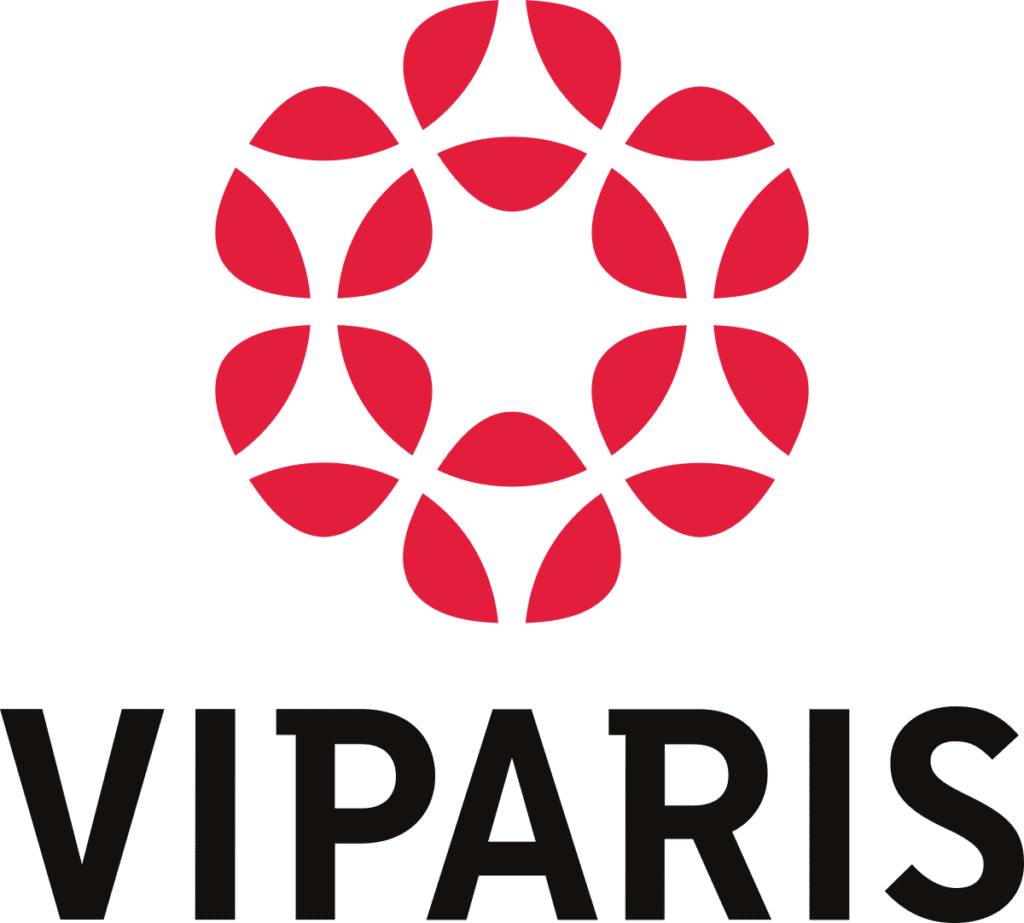Notre Blog
Intervenir sur des incidents : Le cadre général pour le maintien de l’ordre
15 février 2022

Un évènement récent (et rare) peut rappeler quelques principes fondamentaux. Dans le cas présent, celui de la proportionnalité des moyens de maintien de l’ordre. Lors d’un match de football, suite à des incidents entre supporters, une intervention des forces de l’ordre belges a été engagée. Il semble que la réaction de la Police ait été disproportionnée par rapport à la menace réelle.
Le sociologue Max Weber avait -il y a fort longtemps- défini la violence physique légitime, notion clé en droit comme en sciences politiques. L’Etat -avec un grand E- se verrait conférer le monopole de la violence et de son usage dans une logique de contrôle social.
Dans le cas moins général de la sécurité des manifestations, aussi bien les forces de l’ordre publiques que les services d’ordre privés disposent de moyens d’action. Dans les deux cas, tout n’est pas autorisé, même au nom de la sécurité. Toutes les opérations engagent la responsabilité des agents s’ils s’écartent du cadre réglementaire et agissent sans discernement.
Ainsi, pour les agents de sécurité privées, le code de la sécurité intérieurs dans son livre VI (art.631 notamment) rappelle l’existence d’un code de déontologie qui complète les mesures administratives et les sanctions pénales « classiques » prévus par les lois et règlements.
L’alinéa 7 de l’article 631 est des plus éclairant sur la logique générale de l’action : « Attitude professionnelle.
En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité. Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise. »
Le point 10 concerne plus particulièrement l’usage éventuelle de la violence : « Interdiction de toute violence.
Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères.
Lorsqu’un acteur de la sécurité privée, dans l’exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l’a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. »
Le texte rappelle, sans ambiguïté le cadre très strict dans lequel s’exerce l’activité des agents : en dehors de la légitime défense, peu de moyens d’action coercitifs existent pour la sécurité privée. A rappeler régulièrement aux intervenants…
Partager l’article
Recent Post
-
 Victimes de mouvements de foule : les plus faibles sont les plus exposés05 Juil 2024 Actualités
Victimes de mouvements de foule : les plus faibles sont les plus exposés05 Juil 2024 Actualités -
 L’exposition médiatique, ça attire !27 Juin 2024 Actualités
L’exposition médiatique, ça attire !27 Juin 2024 Actualités -
 Les premières fois sont difficiles…. après ça va mieux (en principe) !19 Juin 2024 Actualités
Les premières fois sont difficiles…. après ça va mieux (en principe) !19 Juin 2024 Actualités -
 Modéliser et apprendre : les principes de la sécurité évènementielle12 Juin 2024 R&D
Modéliser et apprendre : les principes de la sécurité évènementielle12 Juin 2024 R&D -
 Annuler au tout dernier moment : quelles conséquences ?05 Juin 2024 Actualités
Annuler au tout dernier moment : quelles conséquences ?05 Juin 2024 Actualités
Categories
Notre ingénierie adaptée
à vos besoins
Votre interlocuteur unique pour gérer tous les aspects de la sécurité de votre événement
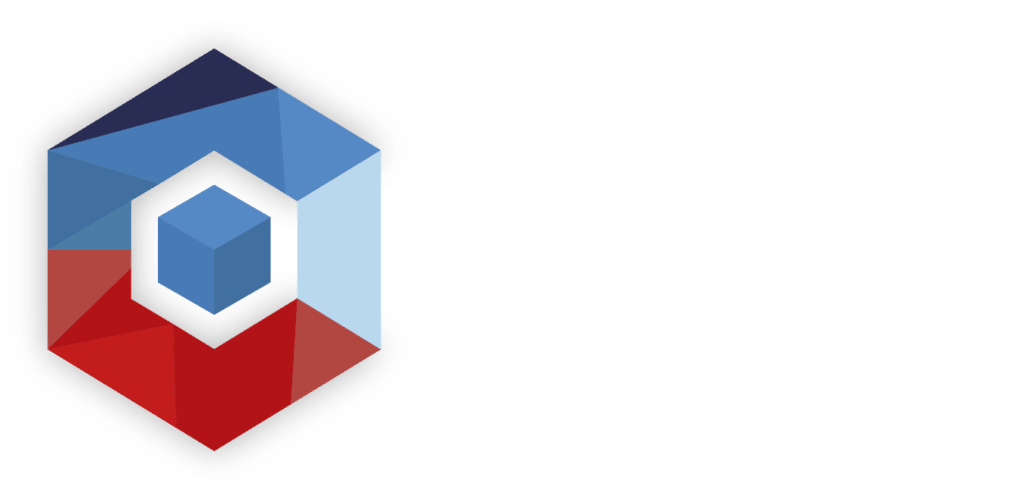
Gagnez du temps
dans la gestion
de votre dispositif sécurité !
Structurez la sécurisation de vos événements avec Smart Security Event, solution d’automatisation des outils sécurité.

- Paris - FRANCE
- contact@cispe.fr
- +33 2 43 49 75 01
Design by STBK ©
Centre d’Ingénierie de la Sécurité Privée des Événements © 2021 – Mentions Légales